Traitement de l’hypertension chronique
Dans les rares cas où la cause de l’hypertension chronique est connue, le traitement peut parfois aboutir à la guérison (en retirant par voie chirurgicale un adénome de Conn par exemple).
Le traitement repose sur la compréhension des mécanismes physiopathologiques de régulation de la tension artérielle.
Le traitement de l’hypertension artérielle vise à la normalisation des chiffres tensionnels, afin d’en prévenir les complications. Ces mesures préventives, par certains médicaments, et sur des critères de morbimortalité, ont été prouvées par des essais pour des seuils atteignant 160/95 mmHg (140/80 mmHg chez les patients diabétiques ou après un accident vasculaire cérébral). Il n’existe pas de preuve pour justifier un traitement lorsque les seuils sont inférieurs à ces chiffres. Jusqu’à la dernière mise à jour, les États-Unis ont fait les recommandations en fonction des valeurs inférieures à 140/90, et actuellement elles sont 150/90 pour une personne de plus de 60 ans. Plusieurs moyens peuvent être utilisés.
Règles d’hygiène et de régime alimentaire
Les règles centrées sur l’hygiène de vie et les habitudes alimentaires suffisent parfois à normaliser la pression artérielle et doivent toujours être proposées :
- perte de poids, en cas de surcharge pondérale, afin de maintenir l’IMC (indice de masse corporelle) en dessous de 25 kg-m-2, ou autrement obtenir une baisse de 10 % du poids initial
- suppression de la réglisse, s’il y a lieu
- diminution de la consommation de sel, si possible moins de 6 g/jour, éviter la salière sur la table, les charcuteries, les plats cuisinés
- limiter la consommation d’alcool à moins de 3 verres de vin ou l’équivalent par jour pour l’homme et 2 verres de vin ou l’équivalent par jour pour la femme
- augmenter la consommation de fibres alimentaires, particulièrement avec une alimentation riche en fruits et légumes, et diminuer la consommation des graisses [24], notamment les graisses dites saturées
- augmenter les apports en potassium (à condition d’avoir une fonction rénale normale)
- lutter contre les facteurs de risque afférents (tabagisme, cholestérol, diabète, sédentarité)
- utiliser une pilule faiblement dosée en œstrogènes
- en état neurotonique, éviter le thé, le café, éventuellement associer la relaxation
- dans la mesure du possible, mener une vie calme et régulière, en respectant les heures de sommeil
- recommandation d’exercices physiques : une activité physique aérobique régulière (au moins 30 minutes environ 3 fois par semaine)
- certaines études ont montré que la consommation régulière de chocolat ou d’ail fait baisser légèrement les chiffres de la tension artérielle.
Traitement médical
Il s’agit d’un traitement à vie. Il doit être idéalement simple, efficace et bien toléré. Il doit être bien expliqué. Le fait qu’il existe de nombreux médicaments signifie qu’aucun d’entre eux n’est parfait. Le médecin effectue un choix en fonction du type d’hypertension du patient, des maladies reliées, de l’efficacité, de la tolérance et du coût des différents produits. Il arrive souvent que le patient soit obligé d’essayer successivement plusieurs médicaments avant d’en trouver un qui lui convient.
Si l’hypertension artérielle n’est pas contrôlée au moyen d’un traitement, des complications peuvent se manifester. Il est important de préciser que l’hypertension artérielle en elle-même n’est pas une maladie : elle n’en est qu’un facteur. En d’autres termes, son existence n’est ni nécessaire ni suffisante pour qu’une maladie se développe. L’hypertension est un problème important de santé publique dans la population. Sur le plan individuel, elle n’a qu’une faible valeur prédictive sur le développement de problèmes vasculaires. Ces derniers peuvent être :
- la conséquence « mécanique » de l’augmentation de la pression artérielle sur les vaisseaux (qui peuvent rompre en provoquant des hémorragies)
- la conséquence « mécanique » sur la pompe cardiaque fonctionnant à des pressions élevées pendant longtemps
- la conséquence d’une participation à la formation ou à la croissance d’athérome, obstruant plus ou moins progressivement les artères.
Les principales complications sont tant cardiaques que neurologiques et rénales.
Complications cardiaques
Le surcroît de travail imposé au cœur du fait de l’augmentation de la pression artérielle entraîne une hypertrophie ventriculaire gauche (augmentation du volume) très précocement, pouvant être détectée par électrocardiographie (ECG) ou échographie cardiaque. Cette hypertrophie peut régresser sous un traitement antihypertenseur. Par la suite, si l’hypertension n’est pas contrôlée, les cavités cardiaques se dilatent et la fonction contractile du myocarde (muscle cardiaque) se détériore, entraînant l’apparition des signes d’insuffisance cardiaque. Par ailleurs, l’atteinte athérosclérose des coronaires et les besoins accrus en oxygène d’un cœur hypertrophié expliquent l’apparition fréquente d’une insuffisance coronarienne chez les patients hypertendus. L’hypertension favorise la formation de plaques d’athérosclérose, qui lorsqu’elles se rompent, forment un thrombus (caillot) risquant de se loger au niveau d’une coronaire qui alors se bouche. Celle-ci se trouve ainsi obstruée et la zone cardiaque irriguée normalement se nécrose progressivement jusqu’à ce que survienne l’infarctus du myocarde.
Complications neurologiques
Des modifications rétiniennes peuvent être observées au fond d’œil. Elles donnent donc des indications aux fournisseurs de soins de santé qui peuvent ainsi suivre l’atteinte vasculaire liée à l’hypertension : spasmes, rétrécissement des artérioles, apparition d’exsudats ou d’hémorragies, d’œdème papillaire, etc. Une atteinte du système nerveux central est fréquente. Elle se manifeste particulièrement par la survenue d’une des conditions suivantes :
- un accident vasculaire cérébral hémorragique, une rupture d’un vaisseau cérébral ou ischémique par obstruction d’une artère par de l’athérome ou par un thrombus (conséquence de la rupture d’une plaque d’athérome). Selon l’OMS, un hypertendu court 2 à 3 fois plus de risques de subir un accident vasculaire cérébral
- une encéphalopathie hypertensive (hypertension sévère, troubles de la conscience, rétinopathie avec œdème papillaire, crises convulsives), en cas d’hypertension très élevée
- une maladie artérielle, par atteinte diffuse des artères cérébrales par de l’athérome.
Complications rénales
La néphroangiosclérose est pour sa part le retentissement rénal de l’hypertension artérielle mal contrôlée et elle favorise de ce fait l’apparition d’une insuffisance rénale. L’altération de la fonction rénale est souvent très précoce et modérée, mais elle peut s’aggraver progressivement. Selon l’OMS, ce risque serait de 2 à 10 fois plus élevé chez l’hypertendu.
Autres complications
- Accidents gestationnels (c’est-à-dire chez la femme enceinte). L’hypertension artérielle favorise les accidents gestationnels : éclampsie, mortalité périnatale, etc.
- Complications vasculaires diverses : anévrysme, dissection aortique, artériopathie des membres inférieurs
· Hypertension artérielle maligne : devenue rare aujourd’hui en raison des possibilités de traitement, l’hypertension artérielle maligne se caractérise par une tension artérielle très élevée accompagnée de troubles rénaux, neurologiques (encéphalopathie hypertensive, altérations importantes du fond d’œil) et cardiaques (insuffisance ventriculaire gauche avec œdème pulmonaire aigu).
De nombreuses personnes souffrant d’hypertension artérielle ne ressentent aucun symptôme et le problème se découvre lors d’un examen de routine ou d’une consultation pour autre chose. Dans certains cas, les symptômes révèlent plutôt les effets de l’hypertension artérielle sur l'organisme. Bien qu’ils ne soient pas spécifiques, les principaux symptômes susceptibles de se manifester lorsque la tension artérielle est élevée sont les suivants :
- maux de tête : ils sont principalement une caractéristique de l’hypertension grave. Ils sont normalement présents le matin, dans la région occipitale (cou et dessus)
- acouphènes (sifflements auditifs), phosphènes (perception de points lumineux)
- vertiges
- palpitations (sensation d’accélération du rythme cardiaque)
- asthénie (sensation de fatigue)
- dyspnée (difficulté à respirer)
- épistaxis (saignements de nez)
- hématurie (présence de sang dans l’urine).
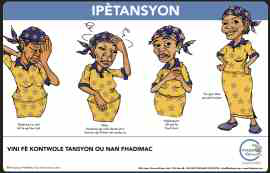
La cause précise de l’hypertension artérielle est encore inconnue dans la grande majorité des cas. Toutefois, sur le plan statistique, il est possible de déceler un certain nombre de circonstances liées à l’hypertension. C’est ce qu’on appelle un facteur de risque. Ce terme indique que le lien de causalité n’est pas établi (il s’agit seulement d’un risque statistique). Dans les cas où plusieurs de ces facteurs coexistent fréquemment chez un même patient, la maladie revêt alors un caractère multifactoriel.
L’âge
La pression artérielle augmente avec l’âge. Après la soixantaine, la pression systolique se met à augmenter alors que la pression diastolique s’abaisse, probablement par un phénomène de rigidification des artères. Ainsi, moins de 2 % des sujets de moins de 20 ans sont hypertendus, et ce pourcentage augmente à plus de 40 % après 60 ans.
Le sexe
Avant la ménopause, les hormones féminines constituent un facteur de protection contre le risque cardiovasculaire. Après la ménopause, la courbe du risque cardiovasculaire chez les femmes converge graduellement vers celle des hommes d’âge et de corpulence similaires.
L’hérédité
Il existe un déterminisme génétique de l’hypertension essentielle dont le caractère composite a été démontré.
Le sel
Consommation excessive de sel
Le facteur le plus étudié est la consommation de sel alimentaire (NaCl) dont l’importance pourrait, sinon déclencher, du moins maintenir l’hypertension. L’excès de sel serait responsable de 25 000 décès par an en France (75 000 événements cardiovasculaires).
Autres produits alimentaires
– La consommation chronique d’alcool augmente le niveau de pression artérielle. Les grands buveurs (alcooliques) ont une augmentation de la pression artérielle systolique de plus de 1 cm Hg, en moyenne, par rapport aux non-buveurs.
– La consommation d’acides gras polyinsaturés est inversement proportionnelle au niveau de la pression artérielle.
– La consommation de café s’accompagne d’une augmentation de la pression artérielle, mais l’effet est minime en raison du développement d’une tolérance à la caféine.
– La consommation excessive de réglisse (voir intoxication à la glycyrrhizine ci-dessus).
Poids
Il existe une forte corrélation entre l’indice de la masse corporelle (indice de surpoids, rapport poids/taille) et le niveau de la pression artérielle. En revanche, un régime hypocalorique chez une personne obèse hypertendue engendre une baisse de la pression artérielle.
Diabète
Les personnes diabétiques ont, en moyenne, une pression artérielle plus élevée que le reste de la population.
Effort physique et sédentarité
L’augmentation des chiffres de la pression à l’effort est une réaction physiologique tout à fait normale.
En revanche, l’effet durable d’un entraînement physique adéquat s’accompagne généralement d’une baisse de la pression artérielle au repos. On constate généralement une baisse de la pression artérielle chez la personne qui s’entraîne par rapport à la personne sédentaire.
Autres facteurs
Troubles du sommeil : Les personnes qui ronflent sont atteintes deux fois plus par l’hypertension que celles qui ne ronflent pas.









